
La première étape — parisienne — du projet DAU d’Ilya Khrzhanovsky est terminée — on pourrait dire, le premier tour d’un coureur de longue distance… Un projet monumental, en cours depuis près de dix ans à Kharkov, où a été recréé un Institut de Physique de l’époque stalinienne (le tournage lui-même y allait de 2006 à 2011). Reconstruit dans les moindres détails du passé (parfois étrangement exagérés), habité par des gens, dont beaucoup sont restés et ont vécu sur le site pendant toute la période, portant des vêtements appropriés des années 30 ou 50 (jusqu’aux sous-vêtements authentiques!), se nourrissant de nourriture soviétique et la payant en argent soviétique… Aimer, baiser, se trahir l’un l’autre, rester toujours sous les yeux vigilants des agents du NKVD et d’un objectif de caméra espion. Se soumettre à l’incroyable pression de cette surveillance mais réussir à atteindre des sommets également incroyables de passion et de sincérité… Au total, 700 heures de rushes, des milliers d’objets authentiques, mais avant tout — les habitudes et attitudes acquises et un langage artistique totalement nouveau élaboré…
L’histoire du lauréat du prix Nobel, un physicien soviétique Lev Landau, n’est pas transformée en biopic, mais plutôt en une image capturée par le double objectif d’une caméra-obscura, nous offrant un double regard sur l’histoire douloureuse et criminelle de la Russie. Elle s’est transformée en DAU, le nom finalement donné à l’ensemble du cycle (avec un célèbre chef d’orchestre de Perm, Theodore Currentzis jouant Dau lui-même). L’époque stalinienne et son écho dans la modernité russe. Services Secrets. La pression monstrueuse qui aplatit et paralyse une personne, lui laissant un étroit couloir de possibilités — un couloir sombre avec des plafonds en surplomb, menant… Dieu sait où, surtout vers la trahison et la mort! Un institut privilégié qui, dans son essence, n’est guère meilleur qu’un quelconque Goulag d’esclavage. Fouilles et arrestations nocturnes continues, même ici, dans un appartement commun relativement luxueux pour scientifiques privilégiés, avec ivresse perpétuelle et fêtes de nuit, avec leurs manteaux de fourrure, leurs petits scandales et leurs débats animés… Si l’on considère l’aspect purement visuel et cinématographique des films présentés, le côté claustrophobe de l’image est particulièrement frappant. Plafonds bas de couloirs secrets, salles communes encombrées, pleines de déchets luxueux. Ici, ils boivent toute la nuit, ici, derrière les rideaux, derrière la porte en contreplaqué — ils baisent précipitamment, grossièrement sur des draps froissés, empêtrés dans des couvertures de satin bon marché… Horizon bas, rayons obliques du soleil couchant ou lumière moribonde des lanternes de la cour. La vie misérable indécemment exposée dans les scènes de fouilles nocturnes… Les gardes, les agents du NKVD, ou tout simplement les concierges silencieux, qui marchent régulièrement par paires le long des sentiers et des couloirs… Des images nous renvoyant visuellement à Dancer in the Dark (Dancer dans le noir) de Lars von Trier ou à Querelle de Reiner Werner Fassbinder..
Alors que nous essayons tous de reprendre notre souffle, il est maintenant important d’évaluer au moins les résultats préliminaires (il reste encore Londres et Berlin à venir: nouveaux films et nouveaux événements du programme culturel). Jusqu’à présent, 13 longs métrages ont été achevés (en fait, il y en a déjà plus d’une vingtaine, puisque certains des numéros de la série contiennent réellement deux ou plusieurs œuvres terminées). Près de 40 000 visiteurs qui sont entrés pendant moins de trois semaines dans les trois principaux «lieux de pouvoir» — Théâtre de la Ville, Théâtre du Châtelet et Centre Pompidou avec des «visas» payants (qui fonctionnaient 24h/24 et 7j/7). Beaucoup d’admirateurs, assis sur les marches la nuit, hypnotisés, incapables de s’éloigner d’une expérience insolite et bizarre…
Mais il faut bien l’avouer: dans l’ensemble, les professionnels du théâtre ou du cinéma ici en France n’ont pas accepté ce projet, ou plutôt, ont choisi de ne pas le remarquer. Il est probablement intéressant d’analyser ce qui a causé exactement un rejet aussi net et définitif dans la communauté du théâtre et du cinéma français. Après tout, on ne peut pas sérieusement croire que des professionnels solides puissent être aussi impressionnables, ou faire si aveuglément confiance aux publications de journaux… En fait, j’ai été assez frappée par la réaction de certains de mes amis proches: beaucoup d’entre eux considéraient toute cette expérience comme «maladive», «douloureuse», «vicieuse», bref — malsaine… En effet, je pense que beaucoup de choses s’expliquent par la base même des pratiques performatives en France, dont la compréhension remonte à leurs précieuses Lumières, au célèbre dialogue philosophique de Denis Diderot. Dans son Paradoxe sur le comédien, il est dit que seul un vrai professionnel qui reste froid et imperturbable peut être un bon acteur, c’est-à-dire un professionnel qui n’est pas affecté par aucune passion explosive de son personnage. En fait, c’est là que la fameuse «textocentricité» du théâtre français prend son origine lorsque la tâche de l’interprète n’est que de tenter de justifier le texte d’un auteur étrange par une intonation plausible et convaincante. Le DAU, essentiellement située quelque part à l’intersection du théâtre et du cinéma, offre une approche complètement différente du travail des interprètes. Ce sont tous des êtres vivants, qui restent essentiellement eux-mêmes, qui revivent (à leur propre stupéfaction) des situations réelles et leurs propres réactions, qui vibrent, qui sont étonnés par leurs propres réponses, qui les surprennent invariablement, qui oublient complètement la caméra et qui finalement atteignent ce niveau de sublimation de la passion où peu importe que l’objectif les regarde. Mais alors, que doit faire le spectateur quand tout son être devient involontairement un miroir reflétant le même processus, si tout dans sa nature résonne en écho, et que toute sa sensualité répond à une expérience immédiate et dérangeante! Après tout, si l’amplitude de cette oscillation devient trop grande, tout commence à se briser et à s’écrouler… C’est vraiment un défi douloureux pour un public inexpérimenté… Sans parler d’un spectateur français normal qui a l’habitude de créer une distance de sécurité avec n’importe quel art qui semble trop risqué ou suspect, qui a l’habitude d’insérer un rembourrage de protection entre lui et le spectacle!
Eh bien ici, il vaut la peine de se tourner vers l’aspect le plus intéressant du projet lui-même — le travail avec les artistes-interprètes. La seule actrice professionnelle était une fille qui jouait l’épouse de Dau. Tous les autres ont été recrutés soit parmi des célébrités et des professionnels de divers domaines (pour les principaux «acteurs»), soit parmi certains types, avec la faculté spécifique de captiver l’imagination des spectateurs. Tous les interprètes ont travaillé dans la technique d’improvisation structurée. En d’autres termes, il n’y avait pas de texte de scénario fourni, ce qui a été discuté à l’avance (parfois avec le réalisateur, parfois avec un partenaire) ont été certains repères, des points tournants. Puis tout a été donné à l’improvisation directement sur le site. Avec la caméra qui suit les artistes, parfois pendant des heures. Avec une seule coupe autorisée par le chef opérateur — l’incomparable Jürgen Jürges…
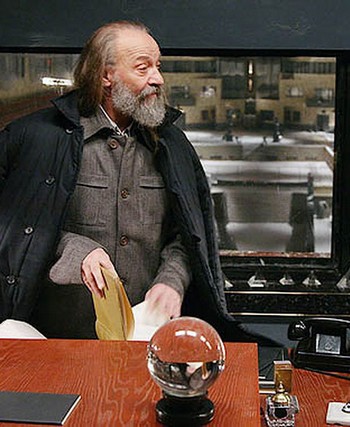
Anatoli Krupitsa – Anatoli Vassiliev
Tout le tissu ardent et douloureux du récit dans DAU n’est pas, bien sûr, une simple tranche de vie spontanée, prise au hasard par l’opérateur, une sorte de reality show. Mais d’autre part, ce n’est pas non plus une construction linéaire, composée autour d’une certaine parcelle, autour d’un scénario fixé par le réalisateur. Des relations très particulières commencent à émerger entre la liberté d’improvisation de l’interprète et la structure interne qui l’habite et qui remonte sans cesse à la surface. Gilles Deleuze nous donne l’image d’un «événement nomade» («hasard pur»), aléatoire, qui aboutit finalement à un éclair soudain, à une explosion, déformant ainsi la causalité habituelle et ennuyeuse du quotidien.
En fait, il y a aussi quelque chose de spécial dans la nature séduisante de la violence, qui constitue le sujet même de la recherche ici, tout en devenant — d’une certaine manière curieuse — l’un des outils majeurs pour façonner et sculpter à la fois l’image et la technique des interprètes eux-mêmes. La séduction, comme le rappelle Jean Baudrillard, «est un processus circulaire, réversible, de défi, de surenchère et de mort» (Jean Baudrillard. De la séduction. Séduction/Production). J’ai moi-même observé un processus assez similaire avec les interprètes pratiquant la technique d’étude, proposé par Anatoli Vassiliev pour ses structures de situation (psychologiques) et structures de jeu (ludiques). Bien sûr, Vassiliev, qui travaille dans le théâtre dramatique, commence toujours par une fondation littéraire, avec le texte de l’auteur. Il examine la structure interne de l’œuvre dramatique, avant de passer (assez rapidement, en quelques jours) au travail d’improvisation des participants… Le cœur du problème réside ici essentiellement dans la détermination du vecteur: une sorte de flèche d’énergie volante et emplumée qui se déplace à sa manière bizarre — du passé au futur (dans les structures psychologiques) ou du futur au présent et au passé (dans les structures ludiques). Je pense qu’en août 2008, quand Ilya Khrzhanovsky, qui était venu au théâtre antique d’Épidaure pour la première de Médée de Vassiliev, lui a suggéré une possible participation au projet de DAU à Kharkov, Vassiliev a accepté sans aucune hésitation. Les principes créatifs de la construction du tissu performatif étaient ici beaucoup trop proches, trop liés et consanguins pour être rejetés. La tentation de mélanger cette potion, ce breuvage, où la nature humaine elle-même, avec tous ses rebondissements personnels, est utilisée pour aller au-delà, est d’avance prête à la transgression, était beaucoup trop forte… Et la plus grande tentation n’était pas seulement de diriger les autres, mais — comme si tout d’un coup s’embarquant dans une aventure risquée — d’essayez de faire tout cela avec sa propre nature d’acteur.

Anatoli Krupitsa – Anatoli Vassiliev et Dau – Theodore Currentzis dans « Le retour du fils prodigue »
Vassiliev accepta d’assumer le rôle d’Anatoli Krupitsa (une sorte de paraphrase sur le destin du lauréat du prix Nobel Pyotr Kapitsa), le premier directeur de l’Institut: le directeur du vaste monde, construit selon ses propres lois, le chef du château kafkien, de la citadelle secrète, ou — comme cela a été précisé plus tard dans le premier film du cycle Vassiliev, son propre «état dans l’État». Initialement, il a été supposé que dans cette première période de la création de l’Institut, Vassiliev jouerait en duo avec Theodore Currentzis (son collègue Dau/Landau). Cependant, le champ d’activité s’est finalement considérablement élargi, et suffisamment de choses ont été tournées pour composer au moins quatre longs métrages dans le cadre de l’ensemble du projet. Vassiliev lui-même a décidé de faire la composition, le montage et toute la post-production de ce matériau, où il joue le rôle central. Aujourd’hui, il définit le genre de son œuvre comme «un roman en quatre livres», et les titres des deux premiers numéros sont Le retour du fils prodigue et Guerre et paix. Le premier film présenté en première à Paris raconte le retour de Dau auprès de son patron, presque son père, qu’il a trahi en signant un témoignage détaillé devant les enquêteurs à Kharkov; comme il le dit lui-même — dans une horreur mortelle devant les cachots du NKVD, où il a déjà dû passer quelque temps. Krupitsa insiste pour que Dau revienne: dans cet étrange espace fantasmagorique créé artificiellement, il y a plus de chances de survie…
Une cour fermée, où des gardes, ou des espions, ou simplement des serviteurs et des témoins silencieux, marchent toujours par deux. De larges fenêtres aux vitres épaisses, que les femmes de ménage passent des heures et des heures à frotter. Dau, qui apparaît sur l’escalier enneigé, vêtu d’une veste rouge frappante, qui nous rappelle ses errances à l’étranger. Et ce geste vif et déchirant de Krupitsa, lorsqu’il ouvre la fenêtre, ratisse une poignée de neige sur le rebord de la fenêtre et bourre de force la boule de neige dans la paume de Dau, confus. Vassiliev joue durement, d’une manière brutale et brusque: rien ici qui nous rappelle une motivation psychologique! Au contraire, le spectateur a presque la sensation physique de l’ouverture d’un tube vertical, d’un capot de four dans lequel le vent bourdonne et siffle, — eh bien, le performer monte sans cesse, il s’accroche au partenaire, dans cette sublimation psychologique progressive de plus en plus haute, dépassant les limites des explications naturalistes et des comportements soigneusement motivés. Et le plaisir du jeu gorodki, un peu comme les quilles, quand Krupitsa et Dau tentent, encore et encore, de briser des pyramides complexes de bâtons de bois… Et les poèmes absurdes et sauvages composés sur place par Vassiliev (ils ressemblent aux vers d’un surréaliste russe d’un mouvement OBERIU Alexander Vvedensky ou du capitaine Lebyadkin de Dostoïevski: il propose de fourrer le cul du chef du NKVD, camarade Beria, avec d’une excellente poudre chinoise et de lancer le commissaire dans l’espace, glorifiant ainsi la science soviétique. Et la scène du Parc de la Culture, où dans un cadre étrange, incliné en diagonale, les interlocuteurs semblent atteindre ensemble la vérité humaine ultime (et il y a des peurs et des humiliations, et un moment de tendresse étrange, presque érotique, quand ils se trouvent tous deux dans la neige fondante et la boue, au pied des bottes monumentales de Staline, et autour d’eux, les gens continuent à monter et à descendre avec des sacs à provisions et mallettes, ouvrières et jeunes femmes dactylographes.

« Le retour du fils prodigue »
De beaux dialogues, construits entièrement sur des fondements oniriques, de songes et de rêves: ils parlent de la nature du pouvoir («Le pouvoir doit être aimé, il ne suffit pas de l’endurer, sinon il vous soupçonnera toujours — il faut l’aimer vraiment, aller à son cœur, afin de tout exploser de l’intérieur»). Les disputes sur Don Juan et Faust alternent avec des histoires sur le péché originel et sur les relations avec les femmes… Les mots ici s’envolent facilement d’eux-mêmes, comme des moineaux ou des pigeons, il est clair que personne ne les avait mémorisés auparavant, ils sont si légers et en même temps si maladroits. Au contraire, comme Antonin Artaud l’a déjà dit, «La question d’ailleurs ne se pose pas de faire venir sur la scène et directement des idées métaphysiques, mais de créer des sortes de tentations, d’appels d’air autour de ces idées. Et l’humour avec son anarchie, la poésie avec son symbolisme et ses images, donnent comme une première notion des moyens de canaliser la tentation de ces idées» (Antonin Artaud. Le Théâtre et son double. Le théâtre de la cruauté (Premier manifeste)). Les interlocuteurs boivent du cognac et fument leurs innombrables cigarettes, mais chaque fois qu’une autre idée métaphysique apparaît devant nos yeux, Vassiliev parvient à faire tomber le pathos avec une blague surréaliste — ou il sort simplement un jouet mécanique de l’étagère, une ballerine qui ressemble à un insecte terrifiant, levant les jambes sur un plateau de bronze… Ces deux partenaires, inextricablement liés dans une liasse de dialogues, semblent flotter dans une mer sombre et brumeuse, où les rivages ne sont pas visibles, où la tension explose de temps en temps par des virages brusques et inattendus.
Le deuxième film du «roman» de Vassiliev, intitulé Guerre et paix, est principalement consacré aux dialogues de physiciens russes et étrangers, vieilles connaissances de grands laboratoires scientifiques, réunis au début des années 40, au moment même où la guerre éclate. Dans ce matériel, sélectionné et édité par Vassiliev lui-même, on trouve des arguments sur la nature du fascisme (y compris les raisonnements inattendus du scientifique italien Carlo Rovelli, qui est censé venir de l’Italie de Mussolini: il parle surtout de la tentation esthétique et artistique du fascisme, de la beauté de la passion débridée et sauvage). Mais au d film se trouve un dialogue entre le célèbre metteur en scène Peter Sellars (qui joue un physicien invité) et Krupitsa (Vassiliev), un dialogue qui tourne autour de l’ancien texte bouddhiste Vimalakīrti-Nirdeśa-Sūtra (Preceptes de Vimalakīrti). La figure du laïque Vimalakīrti, qui, selon l’audacieuse disposition du récit, se permet d’enseigner aux moines éclairés, sert de base. Le texte philosophique lui-même est interrompu par des moments soudains, lorsqu’un exemple inattendu s’immisce dans la discussion, modifiant complètement la perspective de la réflexion. Oui, et Sellars lui-même, mentor et prosélyte bouddhiste, suggère soudain à chacun de l’honorable assemblée une expérience méditative risquée: oser et regarder directement dans les yeux de sa mère morte.

« Guerre et Paix »
Nous arrivons ici à cette idée de la vision sténopéique, c’est-à-dire, une vision artificiellement pressée, étroitement focalisée, qui donne tout à coup une focalisation et une netteté complètement différentes. Et avec tout cela — à l’idée même du regard, de voyeurisme, qui est si important pour tout le projet DAU, lorsque le regard d’un observateur occasionnel passe par un trou de serrure étroit. Nous pouvons nous-mêmes organiser cette entrée — par l’ouverture instantanée, semblable à une piqûre d’épingle, par une fissure, une fente étroite du «moment» phénoménal. Eh bien, les philosophes peuvent choisir ici parmi toute une chaîne de synonymes pour désigner cette fissure instantanée, ce trou soudain dans la surface de l’existence, jusqu’alors lisse et dense. La «cassure», «fente» (Riß) de Martin Heidegger, la «brèche», la «fissure à travers laquelle la lumière brille» (zazor) d’Anatoli Vassiliev et le «moment», «instant» (Øieblik) de Søren Kierkegaard se rapportent simultanément à «l’œil» et au «regard» («en un clin d’oeil»). Ou le «balayage des cils» (resnota), nous révélant pour la première fois la vision du monde sous un angle différent, à travers une ouverture spécialement créée (Sigismund Krzhizhanovsky. Filosofema o teatre (Philosophème sur le théâtre)).
Toutes les théories de «l’énergie» dans le théâtre et dans l’art en général sont fondées sur l’image d’une force sauvage et puissante qui se presse, se faufile à travers cette ouverture étroite: des œuvres de penseurs religieux du Shivaïsme du Cachemire (Abhinavagupta, Kshemaraja) aux traités de Kierkegaard (avec son concept de «passion» — Lidenskab — en tant que paradigme unique de la pratique esthétique et de l’expérience religieuse), les écrits fiévreux d’Artaud (où la cruauté n’est pas, bien sûr, la brutalité noire ou sale, mais plutôt le fondement, la source très ardente et dangereuse de notre vie, ainsi que de l’expérience artistique…), — jusqu’à Jerzy Grotowski qui désirait construire des «tunnels» et des «canaux» pour se connecter à la transcendance par des éclats de tension sans cesse renouvelés, tissant ainsi un lien mental d’une personne aux rythmes universels. Jusqu’à Vassiliev lui-même, pratiquant une technique d’étude assez dure et impitoyable, utilisant la capacité d’un novice à s’ouvrir à des impulsions extrêmes et radicales de sa propre nature — que le réalisateur n’a plus qu’à guider et façonner correctement pour son œuvre achevée.
En général, l’expérience de la confrontation politique est présentée dans DAU principalement comme une expérience spirituelle et esthétique. Elle ne peut exister sans deux conditions: sans une immersion dangereuse et extrême dans les couches profondes de notre conscience, — ainsi que sans moyens esthétiques de résistance et de dépassement. Dans son Épilogue au Postdramatisches Theater (Le Théâtre post-dramatique), Hans-Thies Lehmann dit que les moyens esthétiques deviennent une méthode de lutte politique beaucoup plus efficace que n’importe quel manifeste de parti. Pour rompre avec cette fusion de criminels et de forces de sécurité, pour saper les conspirations bureaucratiques, leurs stratagèmes contre nous tous, nous ne pouvons qu’utiliser des méthodes artistiques et de nouvelles formes, — un marteau d’une esthétique nouvelle qui finira par les désorienter et établir de nouvelles règles.
Comme le disait Jean Baudrillard: «Le pouvoir séduit. Mais pas au sens vulgaire d’un désir des masses, d’un désir complice (tautologie qui revient à fonder la séduction dans le désir des autres) — non: il séduit par cette réversibilité qui le hante… Pas de positions séparées: le pouvoir s’accomplit selon une relation duelle, où il jette à la société un défi, et où il est mis au défi d’exister. S’il ne peut s’«échanger» selon ce cycle minimal de séduction, de défi et de ruse, il disparaît tout simplement.» (Jean Baudrillard. De la séduction. Séduction/Production). Je pense que ce qu’on voit d’abord dans sa propre expérience, quelque chose qu’on est horrifié de découvrir en soi-même, c’est ce modèle d’interaction mutuelle, d’interpénétration. Et peut-être un mot plus important ici est la contamination croisée, l’infection. Être infecté par cette séduction de relations sadomasochistes qui sont toujours intrinsèquement érotiques et donc, dans un sens, follement attirantes (d’une manière plutôt dostoïevskienne). Étant infecté par le syndrome de Stockholm, c’est essayer encore et encore de trouver des excuses — pas tant pour justifier sa propre lâcheté que pour justifier le bourreau qui t’humilie… Un fléau maudit et damné qui répand ses spores partout…

Et pourtant, la réaction à cette infection, à cette peste est différente. On peut prendre au moins deux films (à mon avis, parmi les meilleurs du projet): Natasha et Brave People (Gens courageux). Dans le premier, l’agent de sécurité Agippo essaye de recruter une barmaid, qui s’était auparavant permis d’être un peu négligente pour coucher avec un étranger. Eh bien, cette fille, bien frottée de vie, rusée et en même temps simple d’esprit, parfois — une musaraigne tapageuse, parfois — une rêveuse émouvante et sentimentale, cette fille simple est tout à fait prête à signer n’importe quel papier annonçant sa coopération. Elle se tient même avec une certaine dignité, pensant qu’elle est totalement protégée par sa volonté d’accepter à l’avance, d’accepter toutes les règles du jeu. C’est juste que les règles elles-mêmes ne lui sont pas entièrement connues. Un jeu spécial où ce n’est pas le matériel humain qui est important, mais plutôt cette routine formelle elle-même. Encore une fois, Baudrillard nous explique tout: «La récurrence du jeu procède d’une règle, et c’est une figure de séduction et de plaisir… affect ou représentation, toute figure répétitive de sens est une figure de mort… La récurrence du jeu procède alors directement du destin, et elle est là comme destin. Non pas comme pulsion de mort,.. jusqu’aux crépuscules en tropiques des systèmes de sens, mais une forme d’incantation rituelle, de cérémonial où les signes exerçant une sorte d’attraction violente les uns sur les autres ne laissent plus place au sens, et ne peuvent que se redoubler.» (Jean Baudrillard. De la séduction. La passion de la règle). Ce qu’il faut, ce n’est pas seulement une signature sur une feuille de papier, c’est toute la cérémonie de la destruction, de la diffamation physique. Après avoir été cruellement battue, Natasha, nue, est forcée de se violer avec une bouteille. Elle retourne ensuite dans le bureau de l’agent de sécurité, essayant naïvement d’utiliser tous ces jolis trucs féminins toutes ces choses mignonnes qui ont si bien marché dans sa vie antérieure: après tous ces exercices saliques elle essaye toujours de flirter, de murmurer quelque sur ses «beaux yeux», se défendre, comme elle seule peut et sait comment… Ils s’embrassent même au revoir comme de bons amis! Mais Natasha ne voit pas comment, plus tard, Agippo se rince la bouche avec de la vodka, crachant tout le goût possible qui persiste de ce sous-humain finalement humilié…
Et Brave People — Andrei et Dasha, qui appartiennent déjà à la «classe créative»… Les stratégies de résistance sont différentes ici. On voit un vrai physicien londonien, l’un des auteurs de la «théorie des cordes», Andrei Losev, qui n’a pas seulement visité le projet avec d’autres célébrités, mais qui a véritablement grandi dans cette réalité, Andrei, qui vit dans l’appartement commun des scientifiques avec sa femme Dasha. Comme il est réel, comme il est facile de s’identifier à lui! Avec tout son conformisme inévitable des discours loyalistes à la réunion du parti, avec toute sa lâcheté touchante. Et pourtant — la possibilité de créativité, même dans ces conditions diaboliques de violence et de surveillance, tout ça compte… Et ce petit juif intelligent, faible et obéissant, tient jusqu’au bout: il est littéralement crucifié, barbouillé contre le mur du bureau de sécurité pendant l’interrogatoire, mais dans le gémissement pitoyable d’une personne presque brisée, presque écrasée, on peut encore discerner le même «non!». Une scène merveilleuse quand il se saoule chez soi plus tard, une scène merveilleuse d’un scandale communautaire désespéré et absurde, une scène merveilleuse d’amour, de sexe tendre entre époux — présentée comme le refuge ultime, comme la seule île de l’humanité qui reste… Et l’hystérie douloureuse de Dasha — sa propre façon de résister, de s’accrocher à lui, de ne pas rompre les relations, avec de cris vains: «sauve-moi!», «emmène-moi loin d’ici!» L’emmener — où? La boîte est hermétiquement fermée, la galerie qui est toujours surveillée, avec sa vue panoramique en rond, ne te laisserait jamais sortir…
Il s’avère que les vestiges de la dignité humaine, les vestiges de la moralité humaine sont partiellement protégés (bien que non garantis) par une seule chose — la créativité, la capacité à se dépasser, la capacité à inventer, à construire quelque chose de nouveau. En ce sens, une autre variante de la résistance est montrée par le directeur de l’Institut Anatoli Krupitsa, même s’il a lui-même contribué à créer cette gigantesque utopie constructiviste… Il s’y connaît en conception d’univers imaginaires, qui se transforment miraculeusement, comme par magie, en bâtiments théâtraux monumentaux, en performances puissantes, en improvisations spécialement préparées et en même temps essentiellement spontanées… Comme il le dit dans le premier film à son ami et collègue Dau: «nous sommes avant tout des physiciens… tu es un romantique et moi, je suis un praticien». En fin de compte, c’est seulement la créativité qui sauve.
Et maintenant j’aimerais ajouter quelque chose d’assez risqué. C’est la créativité, qui est elle-même initialement infectée par la peste. La créativité, toujours en croissance à partir d’une source noire et sombre de passion boueuse. Il y a dans la nature humaine celle-ci, cette énergie dionysiaque, cette tournure extatique de violence, douleur, bouche douloureusement ouverte, qui se brise en un cri silencieux… L’intrépide visionnaire, Antonin Artaud, en a parlé — après tout, pour lui, le moment de la créativité, surtout l’instant de la vraie création théâtrale et performative s’apparente à une plaie infection de la peste (Antonin Artaud. Le Théâtre et son double. Le théâtre et la peste). C’est ainsi qu’est né le théâtre de la cruauté, où la cruauté n’est pas le revêtement intérieur, laid et sordide, des relations sociales, mais le soleil noir lui-même, qui se manifeste dans un paroxysme de passion… L’artiste peut résister — ne serait-ce que seulement parce qu’en lui il y a un miroir semblable, reflétant le même abîme noir, la même pulsation criminelle d’une passion anarchique, sans loi… Et c’est exactement dans quelle mesure la créativité d’un artiste pareil dépasse les bornes, transgresse le cadre moral des obligations sociales, que Lars von Trier nous a parlé dans sa parabole sur la nature de la créativité — The House That Jack Built (La Maison que Jack a construite).
Crédit photo: Phenomen IP, 2019

